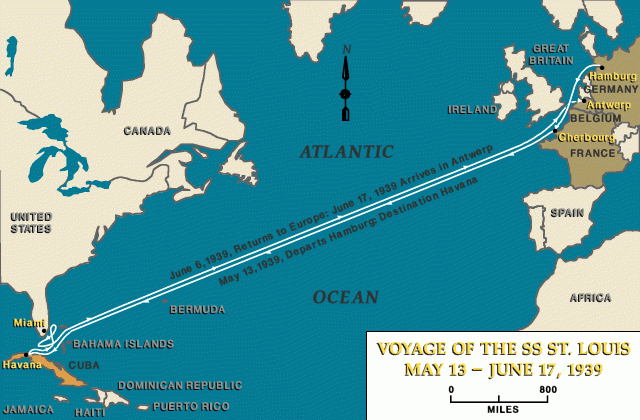Le retour du Saint Louis en Europe
Après s’être vu refuser l’asile à Cuba et ignorer leurs appels pour entrer aux États-Unis, les passagers du Saint Louis débarquent en Grande-Bretagne, en France, en Belgique ou aux Pays-Bas. Dans chacun de ces pays, un certain nombre de facteurs influe ensuite sur leur sort, notamment la géographie locale et l’évolution de la guerre contre l’Allemagne.
Points de repère
-
1
Dans chaque pays, les réfugiés sont confrontés à l’incertitude et à des difficultés financières. Dans un premier temps, ils bénéficient d’un statut temporaire et, souvent, d’un hébergement dans des camps de réfugiés.
-
2
Les passagers vivent des expériences semblables à celles d’autres Juifs dans l’Europe occidentale occupée par les Nazis. Les Allemands assassinent un grand nombre d’entre eux dans les camps de concentration et les centres de mise à mort. D’autres se cachent ou survivent à des années de travail forcé. Certains réussissent à s’échapper.
-
3
Sur les 620 passagers qui rejoignent le continent européen, 532 se voient pris au piège tandis que l’Allemagne conquiert l’Europe de l’Ouest. Un peu plus de la moitié, 278, survivent à la Shoah. Le nombre de passagers qui trouvent la mort s’élève à 254 : 84 qui avait gagné la Belgique, 84 qui avaient trouvé refuge en Hollande et 86 qui avaient été admis en France.
Le 6 juin 1939, le Saint Louis remit le cap sur l’Europe. Sept jours plus tard, alors que le navire traversait l’Atlantique, un accord fut conclu, donnant un nouvel espoir aux passagers. Grâce à une collaboration avec d’autres organisations juives européennes et des représentants du gouvernement, Morris Troper, directeur européen du Joint Distribution Committee (JDC), avait pris des dispositions pour que les passagers du Saint Louis puissent entrer en Grande-Bretagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas. La Grande-Bretagne en accueillit 287, la France 224, la Belgique 214, et les Pays-Bas 181.

Le Saint Louis arriva le 17 juin dans le port d’Anvers, en Belgique, après avoir passé plus d’un mois en mer. Moins de trois mois plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclata. En un an, toute l’Europe de l’Ouest allait passer sous occupation allemande et la terreur nazie allait à nouveau menacer les anciens passagers présents sur le continent.
Avant de débarquer, ils durent remplir des questionnaires que les représentants du gouvernement et des organismes d’aide humanitaire utilisèrent peut-être pour décider de leur destination. On leur demandait les noms des amis et parents qu’ils pouvaient avoir en Grande-Bretagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, ainsi que des renseignements sur leur demande de visa américain et leur numéro sur la liste d’attente des quotas, qui montraient leur intention d’entrer aux États-Unis. Les réfugiés ne se voyant accorder qu’un asile temporaire, ils devaient accepter d’émigrer vers une autre destination de manière plus définitive. On partait du principe qu’ils s’en iraient dès que leur numéro sur la liste d’attente des quotas américains serait appelé ou lorsqu’ils trouveraient un endroit où aller. Les représentants gouvernementaux, déjà inquiets du déferlement de réfugiés juifs du Reich, déclarèrent expressément que le traitement accordé aux passagers du Saint Louis était un cas exceptionnel et ne constituait en aucun cas un précédent pour les autres réfugiés fuyant l’Allemagne.
Les passagers se dirigeant vers la Belgique débarquèrent les premiers et prirent un train spécial pour Bruxelles où ils passèrent la nuit. Ceux qui n’avaient pas de famille en ville furent emmenés dans un centre de réfugiés dans la province de Liège.
Les passagers choisis pour les Pays-Bas embarquèrent le jour suivant sur le Jan van Arkel. À leur arrivée à Rotterdam, les autorités néerlandaises les conduisirent dans un centre de réfugiés provisoire où ils restèrent jusqu’à ce qu’ils trouvent un logement ou soient dirigés vers d’autres camps de réfugiés.
Les passagers destinés à la France et à la Grande-Bretagne montèrent à bord d’un cargo qui avait été réparé pour les accueillir. Le bateau arriva le 20 juin à Boulogne-sur-Mer, où débarquèrent ceux qui avaient la France pour destination. Le lendemain, ceux-ci furent envoyés au Mans, à Laval et dans d’autres villes. Le JDC fit en sorte qu’une soixantaine d’enfants soient pris en charge par l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE). Ils furent placés dans plusieurs foyers à Montmorency, au nord de Paris.
Le 21 juin, les passagers qui devaient gagner la Grande-Bretagne arrivèrent à Southampton et furent conduits par train spécial à Londres. Là, le Comité d’assistance juif-allemand organisa l’hébergement de ceux qui ne résidaient pas avec leurs proches ou chez des amis. La plupart des passagers furent envoyés dans des familles ou des hôtels, mais près de 50 hommes célibataires furent emmenés dans un ancien camp de l’armée britannique, dans le Kent, que le gouvernement avait affecté aux réfugiés.
Les anciens passagers durent affronter l’incertitude et les privations financières. Lors de leur départ d’Allemagne, ils avaient été systématiquement dépossédés de leurs biens par les Nazis et il leur avait été interdit de travailler. Par conséquent, ils dépendaient totalement de parents et d’organismes juifs d’aide humanitaire. Pour les empêcher de devenir un poids pour la société, le JDC consentit à allouer 500 000 $ (une partie conséquente de ses fonds) pour pourvoir aux besoins des réfugiés.
La plupart des anciens passagers avaient espéré trouver un foyer permanent, essentiellement aux États-Unis. Les 600 personnes, peut-être plus, inscrites sur les listes d’attente de visas américains attendirent patiemment que leur numéro soit appelé. D’autres tentèrent d’obtenir des visas d’entrée dans les consulats étrangers, mais peu de pays étaient prêts à accepter des immigrants démunis. Le Livre Blanc publié en 1939 par le gouvernement britannique n’arrangea pas la situation puisqu’il limitait considérablement l’immigration en Palestine.