
Le front de l’Est : la guerre de l’Allemagne contre l’Union Soviétique
L’Allemagne nazie et ses alliés envahissent l’Union soviétique le 22 juin 1941. Rapidement, ils s’emparent de vastes territoires. C’est une « guerre d’anéantissement » que l’armée allemande mène contre l’Union soviétique et ses habitants, et des millions de civils sont tués. L’armée soviétique parvient cependant à repousser les Allemands et, au printemps 1945, à prendre Berlin. Souvent appelé « front de l’Est », le théâtre d’opérations germano-soviétique est le plus grand et le plus meurtrier de la Seconde Guerre mondiale.
Points de repère
-
1
Adolf Hitler a toujours eu l’intention de détruire l’Union soviétique et d’établir un Lebensraum (espace vital) pour le peuple allemand en territoire soviétique.
-
2
L’Allemagne nazie mène une « guerre d’anéantissement » contre l’Union soviétique qui vise à tuer des millions de civils. C’est par l’assassinat systématique de Juifs derrière le front de l’Est que s’amorce la politique nazie de la « solution finale ».
-
3
Les combats et les pertes de l’Allemagne nazie sur le front de l’Est la rendent vulnérable aux invasions des Alliés en Italie et en France, entraînant sa défaite totale.
L’Union Soviétique (URSS)
L’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS, ou Union soviétique) commença son existence formelle en tant qu’État en 1922. Dictature communiste dirigée depuis Moscou, c’est Joseph Staline qui était à sa tête pendant la Seconde Guerre mondiale.
L’Union soviétique était née de l’effondrement de l’empire russe et de la guerre civile russe (1917–1922). En février 1917, une révolution populaire chassa le tsar de Russie du pouvoir et le régime impérial fut remplacé par un gouvernement provisoire. Cette révolution fut suivie par un coup d’État en octobre 1917, qui permit à Lénine et au parti bolchévique de prendre le pouvoir. Celui-ci adopta le nom de « parti communiste » en 1918. Le coup d’État bolchévique entraîna une guerre civile grâce à laquelle les communistes purent contrôler la majeure partie de l’ancien Empire russe. Les territoires soviétiques comprenaient désormais la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie, entre autres.
L’URSS cherchait activement à fomenter une révolution communiste mondiale au nom de la classe ouvrière internationale. Des mouvements communistes existaient déjà dans pratiquement tous les pays industrialisés du monde. Nombre d’entre eux suivaient le leadership de l’Union soviétique, qui était alors le seul État communiste. L’objectif était d’éliminer toutes distinctions nationales, sociales et économiques entre les individus ainsi que d’abolir les institutions religieuses. Puisque l’on ne pouvait s’attendre à ce que les élites dirigeantes d’un pays abandonnent le pouvoir de leur plein gré, les communistes prônaient la révolution violente. Aussi, des soulèvements sanglants eurent lieu en Allemagne et ailleurs en Europe après la Première Guerre mondiale. L’Union soviétique fut alors considérée comme une menace grave partout dans le monde, en particulier par les membres de religions établies, par les classes moyennes et supérieures, les partisans de la démocratie libérale, les capitalistes, les nationalistes et les fascistes.
L’Union Soviétique et l’idéologie nazie
Dès sa fondation, le mouvement nazi en Allemagne décrivit l’Union soviétique comme un ennemi avec lequel une confrontation serait inévitable. La vision de l’Union soviétique se basait sur trois principes de son idéologie raciste :
- Hitler considérait les territoires de l’Union soviétique comme un Lebensraum (« espace vital ») revenant de fait aux Allemands. L’Allemagne devait donc conquérir ces territoires et les peupler pour que la « race » allemande triomphe dans la bataille éternelle pour la survie entre les races.
- Les Nazis assuraient que les Juifs avaient créé le communisme bolchévique, qui leur servirait à dominer le monde. C’est pourquoi ils le qualifiaient souvent de « judéo-bolchevisme ». La conquête de l’Union soviétique devenait alors une étape nécessaire pour détruire l’influence des Juifs sur le monde.
- Les Nazis pensaient que les Slaves et d’autres groupes ethniques de l’Union soviétique étaient racialement inférieurs, des ennemis naturels de la « race » allemande.
Leurs six premières années au pouvoir, les Nazis usèrent d’une propagande violente pour attaquer l’Union soviétique. En privé, Hitler parlait sans cesse d’un conflit à venir. Néanmoins, en 1939, l’Allemagne nazie se lança dans une politique stratégique de coopération temporaire. Ce revirement reflétait la décision tactique d’Hitler de sécuriser son flanc oriental tandis que l’Allemagne détruisait la Pologne et triomphait de la France et du Royaume-Uni.
Relations germano-soviétiques, 1939-1941
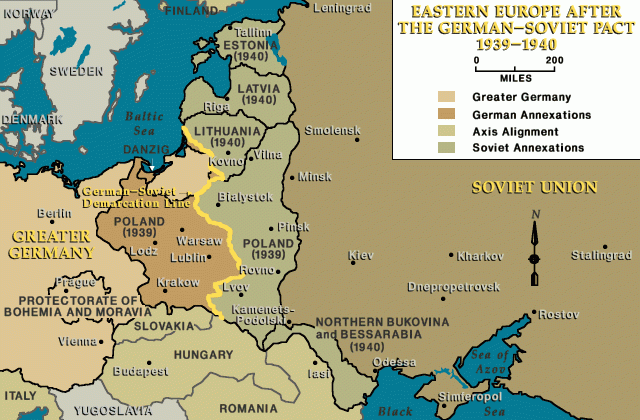
Au cours de l’été 1939, le Japon impérial et l’Union soviétique s’affrontèrent dans une guerre non déclarée en Mandchourie. En août, Staline accepta le pacte offert par l’Allemagne. Il voulait éviter de s’impliquer dans un conflit sur deux fronts, tout comme Hitler. De plus, il espérait qu’une guerre entre l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France affaiblirait ces trois nations et les rendrait vulnérables à des soulèvements communistes pilotés et soutenus par son pays.
Le 23 août 1939, l’Allemagne nazie et l’Union soviétique signèrent le pacte germano-soviétique (également connu en anglais sous le nom de « Molotov-Ribbentrop », d’après les deux ministres des Affaires étrangères qui le négocièrent). L’accord comprenait deux parties, une publique et une secrète : la première, un pacte de non-agression dans lequel les deux pays s’engageaient à ne pas attaquer l’autre pendant dix ans ; et dans le protocole secret, les deux signataires divisèrent l’Europe de l’Est en sphères d’influence allemande et soviétique et se mirent d’accord sur un partage de la Pologne.
Le pacte germano-soviétique permit à l’Allemagne d’attaquer la Pologne le 1er septembre 1939 sans avoir à craindre d’intervention soviétique. Deux jours plus tard, l’Angleterre et la France, qui s’étaient engagées à protéger les frontières polonaises cinq mois plus tôt, déclarèrent la guerre à l’Allemagne. Ces évènements marquèrent le début de la Seconde Guerre mondiale.
Conformément au protocole secret, l’armée soviétique occupa et annexa l’est de la Pologne à l’automne 1939. Le 30 novembre 1939, l’Union soviétique attaqua la Finlande. Après quatre mois de guerre, elle annexa les régions frontalières finlandaises, notamment à proximité de Leningrad (Saint-Pétersbourg). À l’été 1940, elle occupa et absorba les pays baltes et s’empara des provinces roumaines de la Bucovine du Nord et de Bessarabie.
Préparatifs de l'offensive allemande
En juillet 1940, l’Allemagne occupait le Danemark, la Norvège, la Belgique et les Pays-Bas, et avait également battu la France. Hitler décida que le moment était venu de vaincre l’Union soviétique, même si au Royaume-Uni, les combats se poursuivaient. Comme ses dirigeants militaires, il pensait obtenir une victoire allemande rapide qui lui procurerait alors une position inattaquable sur le continent européen.
Les diplomates allemands travaillèrent à sécuriser les liens de l’Allemagne au sud-est de l’Europe. En novembre 1940, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie rejoignirent l’Allemagne et l’Italie au sein de l’alliance de l’Axe. Le 18 décembre 1940, Hitler signa la Directive 21, dite Opération Barbarossa, premier ordre opérationnel pour l’invasion de l’Union soviétique. Au cours du printemps 1941, il en informa ses alliés d’Europe de l’Est.
Invasion de l’Union Soviétique par l’Allemagne
Hitler et ses conseillers planifièrent l’Opération Barbarossa comme une Blitzkrieg (guerre éclair) qui viendrait à bout de l’Armée rouge soviétique en quelques semaines. À l’origine, l’invasion devait commencer en mai, mais elle fut repoussée d’un mois pour que l’Allemagne puisse sécuriser son flanc sud, ce qui fut fait grâce à la conquête de la Grèce et de la Yougoslavie.
Les forces allemandes envahirent des territoires tenus par les Soviétiques le 22 juin 1941, moins de deux ans après la signature du pacte germano-soviétique. L’Opération Barbarossa est considérée comme la plus grande opération militaire de toute l’histoire. Trois armées, fortes de trois millions de soldats allemands, furent bientôt rejointes par plus d’un demi-million de soldats envoyés par les alliés de l’Allemagne (Finlande, Roumanie, Hongrie, Italie, Slovaquie et Croatie). Elles attaquèrent l’Union soviétique sur un large front qui s’étendait de la mer Baltique au nord à la mer Noire au sud.
Pendant des mois, Staline avait refusé d’entendre les avertissements envoyés par le Royaume-Uni et les États-Unis indiquant que l’Allemagne s’apprêtait à envahir l’Union soviétique. L’Allemagne obtint donc une surprise tactique pratiquement totale et, dans un premier temps, les armées soviétiques furent dépassées. Des millions de soldats se trouvèrent encerclés. Privés d’approvisionnement et de renforts, ils furent contraints de se rendre. Après seulement trois semaines de combat, Hitler et ses conseillers militaires étaient convaincus qu’une victoire totale sur l’Union soviétique était à portée de main.
Une guerre d’anéantissement

Hitler et l’armée allemande avaient prévu la campagne contre l’Union soviétique comme une « guerre d’anéantissement » (Vernichtungskrieg), tant contre le gouvernement communiste « judéo-bolchévique » que contre les citoyens soviétiques, en particulier les Juifs. Les chefs de la Wehrmacht (l’armée allemande) ordonnèrent à leurs soldats d’ignorer les règles de la guerre obligeant à protéger les civils et de traiter tous les ennemis « sans merci ».
Les stratèges allemands décidèrent que l’armée allemande vivrait des ressources sur place plutôt que de s’approvisionner depuis l’Allemagne. C’est donc en toute connaissance de cause qu’ils laisseraient des dizaines de millions de civils mourir de faim.
En représailles aux actes de résistance, la Wehrmacht mit en place des punitions collectives contre les civils. Fréquemment, des villages entiers étaient brûlés et leurs habitants assassinés.
Exécutions de masse derrière le front de l’Est
En préparation à la guerre d’anéantissement, le haut commandement de l’armée (Oberkommando des Heeres, OKH) et l’Office central de sûreté du Reich (Reichssicherheitshauptamt, RSHA) négocièrent le déploiement d’Einsatzgruppen SS. Ces troupes étaient chargées de procéder à des exécutions de masse de Juifs, de communistes, et de toutes les personnes considérées comme dangereuses pour la domination à long terme de l’Allemagne sur les territoires soviétiques. Les Einsatzgruppen étaient des équipes spéciales de la police de sûreté (Sicherheitspolizei ou Sipo) et du service de sûreté (Sicherheitsdienst ou SD). Souvent appelées « unités mobiles d’exécution », elles intervenaient directement derrière les lignes de front. Avec d’autres unités des SS et de la police, aidés par la Wehrmacht et des auxiliaires locaux, les Einsatzgruppen abattirent bien plus d’un demi-million de civils avant la fin 1941, parmi lesquels une majorité d’hommes, de femmes et d’enfants juifs. Les meurtres de masse systématiques des Juifs au cours de l’invasion de l’Union soviétique marquèrent le début de la politique de « solution finale » de l’Allemagne nazie visant à l’annihilation des Juifs en Europe.
Meurtres de masse des prisonniers de guerre soviétiques
La politique exterminatrice de l’Allemagne concernait aussi les soldats soviétiques qui s’étaient rendus. La Wehrmacht enferma des millions de prisonniers de guerre soviétiques dans des camps de fortune offrant peu ou pas d’abri, de nourriture ou d’eau, et famine et épidémies produisirent rapidement leur effet. Elle en livra également des centaines de milliers aux SS qui les exécutèrent ou les firent travailler jusqu’à épuisement dans des camps de concentration. En février 1942, moins de huit mois après le début de l’invasion, ce sont deux millions de soldats soviétiques qui moururent en captivité aux mains des Allemands.
Stagnation du front
Début septembre 1941, les forces allemandes avaient gagné les portes de Leningrad, au nord. Elles avaient pris Smolensk au centre, et Dniepropetrovsk au sud, puis atteignirent les abords de Moscou début décembre. Mais avec l’arrivée de l’hiver, cette avancée fut stoppée net.
Après des mois de campagne, l’armée allemande était épuisée. Ayant prévu un effondrement rapide de l’Union soviétique, les stratèges allemands n’avaient pas équipé les troupes pour une campagne d’hiver. En outre, l’avancée avait été si expéditive que les forces avaient dépassé leurs lignes de ravitaillement, vulnérables en raison des distances importantes à parcourir (Moscou se trouve à plus de 1 600 kilomètres à l’est de Berlin).
En décembre 1941, l’Union soviétique lança une vaste contre-attaque sur le centre du front, entraînant le retrait chaotique des Allemands de Moscou. Ceux-ci repoussèrent les offensives soviétiques qui suivirent au nord et au sud, mais il leur fallut près de deux mois pour stabiliser le front à l’est de la ville de Smolensk. Ensuite, ils se regroupèrent, avec l’idée de repartir à l’offensive.
La guerre éclair avait échoué. Les dirigeants allemands n’en étaient pas moins persuadés que l’Union soviétique était au bord de l’effondrement. Ils présumaient que, d’une part, le pays avait pratiquement épuisé ses ressources et que, d’autre part, les citoyens soviétiques étaient mécontents et refuseraient de sacrifier leur vie pour le régime de Staline. En effet, dans certains des premiers territoires dont la Wehrmacht s’était emparée, les Allemands avaient été accueillis en libérateurs.
Mais pendant l’hiver 1941-1942, les Soviétiques évacuèrent leurs usines vers l’est et augmentèrent massivement leur production d’avions, de tanks et d’armement. Le Royaume-Uni et les États-Unis soutinrent ces efforts avec des envois de matériel. Pendant ce temps, les politiques allemandes de meurtres de masse accréditaient la thèse de Staline selon laquelle la survie des Soviétiques devait passer par l’expulsion de l’envahisseur. De plus, les soldats de l’Armée rouge qui battaient en retrait étaient exécutés par le NKVD, la police secrète soviétique. Généralement, face à la perspective de mourir de faim dans un camp allemand s’ils se rendaient ou du peloton d’exécution s’ils reculaient, les soldats soviétiques préférèrent combattre jusqu’à la mort.
Le front de l’Est, 1942–1944

1942–1943
À l’été 1942, l’Allemagne et ses alliés lancèrent une vaste attaque au sud et au sud-est en direction du centre industriel de Stalingrad, sur la Volga, vers les gisements de pétrole du Caucase. Pour l’état-major allemand, s’en emparer entraverait l’effort de guerre soviétique et assurerait suffisamment de ressources en carburant pour l’Allemagne et l’Italie pour poursuivre leur offensive sur tous les fronts, y compris maritimes. Et pour Hitler, la prise de la ville portant le nom de Joseph Staline représenterait une victoire psychologique et stratégique majeure.
En septembre 1942, l’Allemagne était au sommet de sa réussite militaire : elle dominait l’Europe, de la France jusqu’à la Volga et du cercle polaire norvégien au nord de l’Afrique. Dans les trois années depuis qu’elle avait déclenché la Seconde Guerre mondiale, elle n’avait pas connu une seule défaite d’envergure.
Novembre apporta cependant deux revers majeurs. Le 8 novembre, tandis que les forces allemandes s’apprêtaient à prendre Stalingrad, des troupes britanniques et américaines débarquèrent en Afrique du Nord. Pour s’y opposer, Hitler fit transférer des troupes, des armes et des avions depuis le front de l’Est. L’armée rouge lança une contre-offensive d’envergure contre les forces allemandes et roumaines qui tentaient de prendre Stalingrad le 19 novembre. En moins d’une semaine, elle encercla l’ennemi, y compris l’ensemble de la 6e armée allemande. Deux mois de combats acharnés suivirent qui entraînèrent de lourdes pertes dans les deux camps. Les soldats allemands survivants se rendirent entre le 31 janvier et le 2 février 1943.
La défaite de l’Allemagne et la mort ou la capture d’un quart de millions de soldats à Stalingrad choquèrent l’opinion publique allemande et ébranlèrent sa confiance dans la victoire. La campagne sur le front de l’Est avait lourdement entamé les forces et l’armement de l’Allemagne. Parallèlement, les campagnes de bombardement des Alliés entravaient les efforts de réarmement des Allemands et transformaient les villes allemandes en ruines.
1943–1944
En juillet 1943, les Allemands lancèrent une nouvelle offensive majeure à Koursk, en Russie. Pleinement conscients des projets de l’Allemagne, les Soviétiques triomphèrent en quelques jours à peine. Au même moment, les Alliés occidentaux débarquaient en Sicile. Leur arrivée força les Allemands à y envoyer des troupes et c’est à partir de ce moment que les forces allemandes ne cessèrent de reculer sur le front de l’Est sans plus jamais pouvoir reprendre l’offensive.
Fin 1943, les forces soviétiques avaient chassé les troupes allemandes de la majeure partie de l’Ukraine, de pratiquement toute la Russie et de l’est de la Biélorussie. Peu après le débarquement allié en Normandie en juin 1944, elles lancèrent une nouvelle offensive majeure. Cette campagne permit à l’Armée rouge de prendre le contrôle du reste de la Biélorussie et de l’Ukraine, de la plus grande partie des pays baltes et de l’est de la Pologne. En août 1944, les troupes soviétiques avaient passé la frontière allemande et étaient entrées en Prusse orientale (province allemande située entre la Pologne de l’entre-deux-guerres et la Lituanie).
Reddition de l’Allemagne
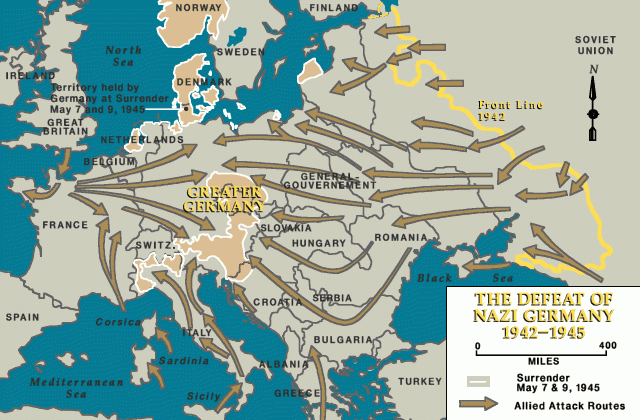
En janvier 1945, une nouvelle offensive mena les troupes soviétiques au fleuve Oder, en Allemagne, à environ 160 km de Berlin.
Mi-avril 1945, l’armée soviétique lança son ultime assaut contre l’Allemagne nazie. Elle prit Vienne le 13 avril et encercla Berlin le 21. Le 25, des patrouilles soviétiques rencontrèrent les troupes américaines à Torgau, sur l’Elbe, dans le centre de l’Allemagne, coupant de ce fait le pays en deux. Après plus d’une semaine de combats acharnés dans les rues de Berlin, des unités soviétiques s’approchèrent du bunker du commandement central d’Hitler. Celui-ci se suicida le 30 avril 1945 et Berlin se rendit aux forces soviétiques le 2 mai 1945.
L’armée allemande se rendit sans condition à l’ouest le 8 mai 1945, puis le 9 mai à l’est. Le même jour, les Soviétiques entrèrent dans Prague, dernière grande ville encore occupée par des unités allemandes. Les Alliés déclarèrent le 8 mai 1945 jour de la victoire des forces alliées en Europe.
Plus de personnes combattirent et moururent sur le front de l’Est que dans toutes les autres campagnes de la Seconde Guerre mondiale réunies.

